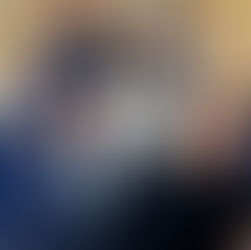Disparues de Nantes, retrouvées à Marseille et en Espagne : que s’est‑il passé pendant leurs trois semaines de cavale ?
- Kiara Elhrach 🔸 Rédactrice 🔸

- 15 juil. 2025
- 3 min de lecture

Deux amies âgées de 15 et 16 ans ont disparu dans la nuit du 25 au 26 juin 2025 après avoir quitté, chacune de son côté, le domicile familial en Loire‑Atlantique — l’une à Nantes même, l’autre dans le nord du département. Scolarisées dans la même maison familiale rurale et déjà connues des services de police pour de précédentes fugues, elles se sont éclipsées sans prévenir personne. Leur disparition a déclenché une vaste mobilisation familiale et policière qui s’est achevée, mi‑juillet, par leur localisation à plusieurs centaines de kilomètres l’une de l’autre : la plus jeune a été retrouvée à Marseille, la seconde repérée en Espagne. Toutes deux sont aujourd’hui saines et sauves, selon leurs proches.
Le point de départ serait une violente dispute survenue au domicile de l’une des adolescentes lorsque son père lui a confisqué son téléphone portable. L’altercation a été suffisamment grave pour nécessiter l’intervention de la gendarmerie. Dans les heures ou jours qui ont suivi, les deux amies ont pris la décision de partir, vraisemblablement ensemble, sans laisser d’explications. Pendant plusieurs jours, aucun contact fiable ne permet de savoir où elles se trouvent.

Le 28 juin, un élément de chronologie émerge : des témoins affirment les avoir vues dans un bowling à Saint‑Sébastien‑sur‑Loire, en périphérie nantaise. Ce sera l’un des derniers signaux concrets avant que la situation ne bascule dans la « disparition inquiétante ». Le 1ᵉʳ juillet, face au silence persistant et à l’absence de trace des jeunes fugueuses, le parquet de Nantes ouvre officiellement une enquête. Dans le même temps, les familles, très mobilisées, lancent des appels à témoins sur les réseaux sociaux, relayant photos et signalements, tout en invitant quiconque aurait aperçu les adolescentes à contacter police ou gendarmerie. Le parquet rappellera toutefois que la diffusion d’informations sauvages peut perturber les investigations ; les enquêteurs ont besoin de travailler sereinement pour recouper les indices.
Le dossier connaît un tournant dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juillet : la benjamine, Sofia, appelle sa mère depuis Marseille (Bouches‑du‑Rhône). Ramenée à Nantes dès le dimanche suivant, elle est entendue au commissariat. Elle explique s’être rendue « par ses propres moyens » jusqu’à la cité phocéenne et affirme s’être séparée de son amie sur place. À ce stade, l’itinéraire, les moyens de transport utilisés et les soutiens éventuels restent flous.

Quelques jours plus tard, le mardi 15 juillet, la seconde adolescente — la plus âgée, Djouliana, 16 ans — est localisée en Espagne. Les circonstances de son passage de la France vers l’étranger n’ont pas encore été établies. Les autorités françaises indiquent qu’elle est saine et sauve, information confirmée par sa famille.
Malgré ces heureuses retrouvailles, une question centrale demeure : comment deux mineures ont‑elles pu parcourir de telles distances en si peu de temps, et surtout après avoir coupé (au moins partiellement) le contact avec leurs proches ? Une source policière nantaise estime qu’il paraît « peu probable » qu’elles aient réalisé l’ensemble de ce périple uniquement par leurs propres moyens. Les enquêteurs s’attachent désormais à reconstituer le fil de leurs déplacements : moyens de transport, hébergements intermédiaires, personnes rencontrées ou ayant prêté assistance, usage (ou non) des réseaux sociaux et d’éventuelles applications de messagerie chiffrée.
L’enquête devra aussi éclaircir la dynamique relationnelle entre les deux amies : sont‑elles parties ensemble dès le départ ? Se sont‑elles séparées ensuite pour éviter d’être repérées ? L’une a‑t‑elle suivi l’autre ? L’épisode de la confiscation de téléphone — élément déclencheur identifié — pourrait s’inscrire dans un contexte plus large de tensions familiales, de mal‑être adolescent, ou de recherche d’autonomie précipitée. Les précédents épisodes de fugue, connus des forces de l’ordre, seront certainement réexaminés afin de détecter d’éventuels schémas récurrents (lieux refuges, contacts encourageant la fuite, conduites à risque).
Pour les familles, l’essentiel est acquis : les adolescentes sont vivantes et de retour sous protection. Mais la phase qui s’ouvre est tout aussi délicate : accompagnement psychologique, médiation familiale, encadrement scolaire renforcé et, si nécessaire, mesures judiciaires de protection des mineurs. Les services sociaux et éducatifs pourraient être associés afin de prévenir une nouvelle fugue.

Cette affaire illustre à quel point la disparition de mineurs — surtout lorsqu’ils sont déjà connus pour fugues répétées — exige une coordination rapide entre familles, forces de l’ordre, magistrats et réseaux de diffusion d’alertes. Elle rappelle également le rôle ambivalent des téléphones et des réseaux sociaux : déclencheurs de conflits domestiques, mais aussi outils essentiels pour retrouver des jeunes en rupture.
Les investigations se poursuivent pour reconstituer, étape par étape, trois semaines de cavale qui ont mené deux adolescentes de Loire‑Atlantique jusqu’au sud de la France puis au‑delà de la frontière espagnole. Reste à comprendre ce qui s’est vraiment joué durant ce périple — impulsion passagère, projet mûri, influence extérieure ou simple fuite en avant adolescente — afin d’éviter que l’histoire ne se répète.